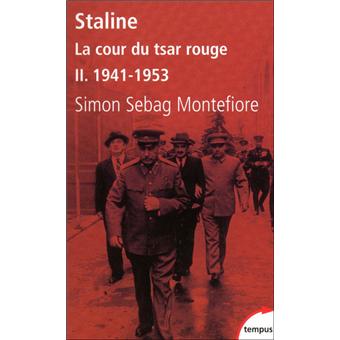 Le tome II est encore plus passionnant que le tome I. Il débute avec l’offensive Barbarossa, le 21 juin 1941, quand sur ordre de Hitler, les chars allemands envahissent l’URSS. Si la décision du Führer allemand a souvent été interprété par ses généraux comme un geste de folie furieuse, l’attitude du dictateur soviétique est au début tout aussi obtuse et irrationnelle, paralysée par sa confiance en Hitler. Contre toute évidence, les rapports de ses espions, les forces allemandes massées aux frontières, les premiers bombardements, il est dans le déni absolu du réel et refuse de croire son état-major. L’invasion a débuté, l’armée russe est en déroute: « Incroyablement entêté, le dictateur persistait à s’accrocher à l’idée d’une provocation des officiers allemands […] « Hitler n’est pas au courant, c’est clair ». Staline refusa de contre attaquer avant d’avoir reçu un message officiel de Berlin. « Ce gredin de Ribbentrop nous a joué un tour » répéta-t-il plusieurs fois à Mikoïan. Il refusait de blâmer Hitler. » Mais quand il prend enfin conscience de son erreur, ivre de fureur, il accuse ses généraux de l’avoir trompé et les tient pour responsables de cette bévue titanesque.
Le tome II est encore plus passionnant que le tome I. Il débute avec l’offensive Barbarossa, le 21 juin 1941, quand sur ordre de Hitler, les chars allemands envahissent l’URSS. Si la décision du Führer allemand a souvent été interprété par ses généraux comme un geste de folie furieuse, l’attitude du dictateur soviétique est au début tout aussi obtuse et irrationnelle, paralysée par sa confiance en Hitler. Contre toute évidence, les rapports de ses espions, les forces allemandes massées aux frontières, les premiers bombardements, il est dans le déni absolu du réel et refuse de croire son état-major. L’invasion a débuté, l’armée russe est en déroute: « Incroyablement entêté, le dictateur persistait à s’accrocher à l’idée d’une provocation des officiers allemands […] « Hitler n’est pas au courant, c’est clair ». Staline refusa de contre attaquer avant d’avoir reçu un message officiel de Berlin. « Ce gredin de Ribbentrop nous a joué un tour » répéta-t-il plusieurs fois à Mikoïan. Il refusait de blâmer Hitler. » Mais quand il prend enfin conscience de son erreur, ivre de fureur, il accuse ses généraux de l’avoir trompé et les tient pour responsables de cette bévue titanesque.
Après avoir totalement décapité la direction de l’armée soviétique lors des purges de 1937 (cf t I), pendant plusieurs jours, Staline paralyse les forces de l’armée rouge en s’enfermant dans son obstination et son aveuglement. Sa responsabilité dans la débâcle initiale de l’armée soviétique semble avéré. Quel fut son rôle réel dans le retournement de la situation, à partir de la défaite de l’armée allemande devant la capitale russe, en novembre-décembre 1941? Loin de se comporter en génie militaire, maréchal auto-proclamé, il démultiplie les hésitations, les ordres et les contre-ordres. Son refus d’évacuer Moscou a certes eu pour effet de galvaniser les forces de résistances. De fait, l’armée allemande a surtout été vaincu par le froid glacial, -30° . La force de Staline tient à son absolue cruauté. « Menacé d’être encerclé au Sud, Staline prit des mesures draconiennes pour que la terreur galvanise ses hommes au combat. La première semaine, il approuva l’ordre n° 246 du NKVD qui stipulait que les familles des soldats capturés par l’ennemi seraient exécutées, ordre qui fut rendu public par le décret n°270 […] Après tout, c’était la vieille méthode des Bolcheviks. »
Le livre ne cache rien du comportement personnel de Staline, les persécution contre sa famille, y compris sa fille à laquelle il reproche une liaison amoureuse au point de faire déporter son compagnon, des attitudes obscènes, d’une saleté hallucinante en public, au milieu de ses généraux, le climat de terreur qu’il fait régner en permanence, menaçant de mort son entourage, tout ordre s’accompagnant d’une menace de pendaison en cas d’échec.
L’idée d’un Staline vainqueur de Stalingrad semble plus que douteuse. De ce qui ressort du livre, la victoire des soviétiques, sur laquelle se joue le sort de l’humanité, tient infiniment plus au courage du peuple russe et à la compétences des généraux russes, qu’au supposé « génie » de Staline, Certes, il se complaît à harceler ses généraux de son arrivée au bureau à midi jusqu’à son coucher à 4 heures. Il ne cesse de hurler, d’humilier, de mépriser son entourage qui tremble devant lui. Comme souvent les grands caractériels, sa tendance est à respecter ceux qui lui tiennent tête et à écraser les plus lâches et lèche-bottes. D’ailleurs, seul, le plus brillant de ses officiers, Joukov, lui tient tête, et face à lui, Staline baisse les yeux. Il ne cache rien non plus des génocides orchestrées, en 1943 et 1944, par Staline et Beria, envers les minorités d’URSS, Allemands de la Volga, Tchétchènes, Ingouches, Kazakhs, Tatars de Crimée, exterminés et déportés par centaines de milliers, ni des tortures, des viols en masse, des persécutions commis par le NKVD, dans l’indifférence absolue du Tsar rouge qui attribue ces atrocités au besoin des soldats de se défouler.
La richesse de l’ouvrage tient au mélange constant de la grande et de la petite histoire. Voici le récit hallucinant d’un dîner entre les délégations soviétiques, américaines et britanniques, à l’issue de la conférence de Yalta, le 6 février 1945, quand les futurs vainqueurs festoient ensemble dans un climat ambigu : « Un hôte inattendu assistait à ce dîner épique: Staline avait en effet invité Beria, ravi d’être sous les feux de la rampe, car il commençait à se sentir un peu à l’étroit dans son rôle de chef des services spéciaux. Roosevelt le remarqua et demanda à Staline: « qui est cet homme au pince-nez, assis en face de l’ambassadeur Gromiko? » « Lui? c’est notre Himmler » [le chef de la Gestapo], répliqua Staline sur un ton malicieux. C’est Beria. » L’homme de la police secrète ne dit rien, se contentant d’un sourire qui révéla ses dents jaunes, mais la remarque lui fit sans doute l’effet d’une douche froide [… ] Il était clair que Beria avait entendu. Les Américains étaient fascinés par cet homme mystérieux. Il était petit, gros, et ses verres épais lui donnaient un air sinistre, mais diaboliquement intelligent. Obsédé par le sexe, Beria se mit à bavarder de la vie sexuelle des poissons avec Sir Archibald Clark Kerr, lui même un séducteur, qui était passablement éméché. De plus en plus ivre, sir Archibald se leva et porta un toast à Beria « celui qui veille sur notre sécurité, notre garde du corps »: un compliment déplacé et maladroit. Churchill, jugeant que Beria était loin d’être un ami recommandable, mit en garde son ambassadeur: « Archie, pas de ça. Fais attention dit-il en le menaçant du doigt. »


